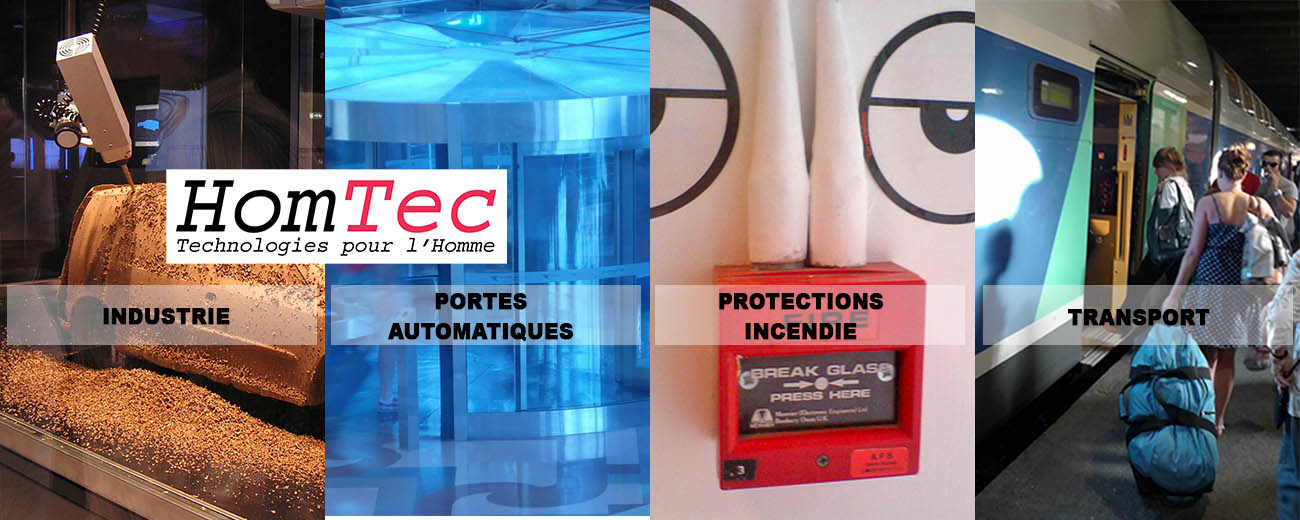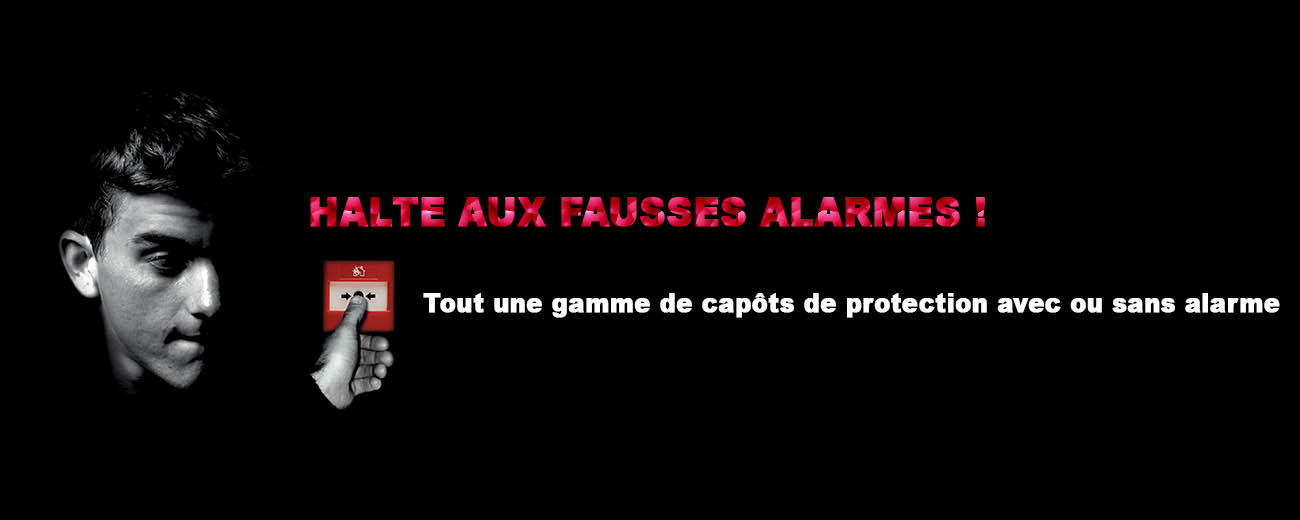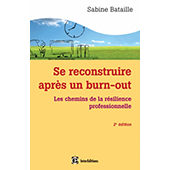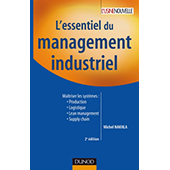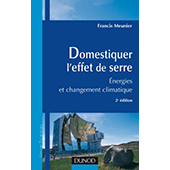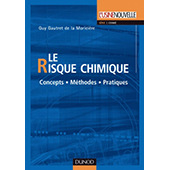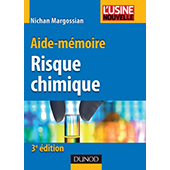"Personnellement, je ne pense pas que l’engagement de proposer 50 VLEP pour horizon 2020 soit respecté", explique Laurent Vogel, juriste et chercheur à l’Etui (European trade union institute de Bruxelles, le centre de recherche de la Confédération européenne des syndicats). Présent lors du dernier colloque du Giscop 93 (Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle) les 1er et 2 juin 2017, il est revenu sur la stratégie de l’Union européenne en matière de cancers d’origine professionnelle. Au cœur de cette stratégie : la directive dite cancérogène, datant de1990, qui instaure des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) à des agents cancérigènes et mutagènes. Cette directive est censée être régulièrement révisée mais elle n'a pas évolué depuis 2004 et ne comporte que 3 VLEP (pour le benzène, le chlorure de vinyle monomère et les poussières de bois durs). Un tournant a cependant été amorcé en 2016.
La première vague en discussion
La Commission a proposé en mai 2016 13 VLEP, dont 11 concernent des substances jusque là absentes de la directive (Voir notre article). Cette proposition est la concrétisation d’un nouveau souffle enregistré l’année dernière sous la pression de la présidence néerlandaise. Ces 13 propositions se trouvent actuellement au stade ce qu’on appelle le trialogue : elles sont discutées entre le Parlement et le Conseil des ministres pour aboutir à un accord. Le Parlement a une position plus ambitieuse que la Commission. Il souhaite notamment que les VLEP proposées pour la silice cristalline et le chrome VI soient respectivement divisées par 2 et par 25. Il recommande également d’instaurer une VLEP de 2mg/m3 pour toutes les poussières de bois et souhaite en instaurer pour sept substances supplémentaires, dont les gaz d’échappement des moteurs diesel. La commission s’y refuse. Son argument : il est difficile de trouver une définition juridique qui ferait la distinction entre les anciens et les nouveaux moteurs diesel.
Élargissement du champ d'application ?
 Le Parlement demande l’extension du champ d’application aux substances toxiques pour la reproduction. Aussi, alors que la Commission refuse de changer le corps de la directive, il veut y instaurer des mesures pour la surveillance de la santé post-emploi – enjeu important étant donné que les cancers se déclarent souvent plusieurs années après l’exposition -, l’obligation pour les États de recueillir les données, ou encore l’obligation de transparence sur les risques associés à chaque VLEP puisque même réduits, ils peuvent rester très importants. Par exemple, avec la VLEP proposée par la Commission pour le chrome hexavalent, un travailleur exposé sur 10 contracterait tout de même un cancer, d'après les études citées par l'Echa (Agence européenne des produits chimiques). Cette valeur est 25 fois supérieure à celle appliquée en France. A ce propos, certaines VLEP européennes ne changeront rien dans l'hexagone parce qu'elles sont plus élevées que celles qui y sont déjà en vigueur, mais d'autres sont au contraire bien plus strictes. Les 31 et 1er juin, le Cese (Comité économique et social européen) a adopté une position proche de celle du Parlement. Au passage, il invite les États membres à veiller à ce que les inspections du travail disposent de ressources financières et humaines suffisantes pour s'acquitter de leurs tâches.
Le Parlement demande l’extension du champ d’application aux substances toxiques pour la reproduction. Aussi, alors que la Commission refuse de changer le corps de la directive, il veut y instaurer des mesures pour la surveillance de la santé post-emploi – enjeu important étant donné que les cancers se déclarent souvent plusieurs années après l’exposition -, l’obligation pour les États de recueillir les données, ou encore l’obligation de transparence sur les risques associés à chaque VLEP puisque même réduits, ils peuvent rester très importants. Par exemple, avec la VLEP proposée par la Commission pour le chrome hexavalent, un travailleur exposé sur 10 contracterait tout de même un cancer, d'après les études citées par l'Echa (Agence européenne des produits chimiques). Cette valeur est 25 fois supérieure à celle appliquée en France. A ce propos, certaines VLEP européennes ne changeront rien dans l'hexagone parce qu'elles sont plus élevées que celles qui y sont déjà en vigueur, mais d'autres sont au contraire bien plus strictes. Les 31 et 1er juin, le Cese (Comité économique et social européen) a adopté une position proche de celle du Parlement. Au passage, il invite les États membres à veiller à ce que les inspections du travail disposent de ressources financières et humaines suffisantes pour s'acquitter de leurs tâches.
Études d’impact polémiques
Début janvier 2017, la Commission européenne a déposé sa deuxième vague de propositions. Elle ne concerne cette fois-ci que 5 VLEP. Elle se rapproche donc très lentement de l’objectif final qu’elle s’était fixée de 50 VLEP à horizon 2020, en passant par une première étape de 25 VLEP avant fin 2016. Cette lenteur serait due aux études d’impact, d’après Laurent Vogel. Et de préciser : "on regarde la balance coûts/bénéfices de chaque décision", alors que pour lui, "leurs immenses marges d’incertitude débouchent sur des décisions très arbitraires". Ce qui le pousse à penser que "le droit est réduit à une fonction de promotion de l’économie. On essaie de vider le débat de sa substance politique, on dit que c’est un simple calcul". Le Parlement devrait adopter son amendement concernant cette deuxième vague de valeurs limite au deuxième semestre 2017.
Les lobbyings dénoncés par des chercheurs
Sans grande surprise, la plupart des participants au colloque du Giscop 93, qu’ils soient chercheurs ou syndicalistes, regrettent la frilosité de l’Europe en matière de prévention des cancers d’origine professionnelle, alors que d'après les estimations, ils seraient à l'origine d'environ 100 000 décès par an. "Le niveau des VLEP est souvent problématique : beaucoup trop élevé. La Commission suit une approche selon laquelle le niveau de risque acceptable peut être considérablement plus élevé en santé au travail qu’en santé publique", résume Laurent Vogel. Le sociologue estime que les syndicats ne sont pas assez investis pour alerter les universitaires et les scientifiques afin de collecter les bonnes statistiques. L’ex-directrice du Giscop 93 Annie Thébaud-Mony, qui rappelle que le principe de la directive de 1990 est quand même la substitution des substances dangereuses (Voir notre article), va plus loin en dénonçant "des institutions scientifiques gangrenées par des relations entre scientifiques et industriels avec la complicité des pouvoirs publics". Une critique qui fait notamment référence à la présence, comme l'expliquait récemment Le Monde, d'experts liés au secteur industriel au sein même du Scoel (le Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle), ou encore, aux expertises industrielles confidentielles sur lesquelles se fonde parfois l'Echa (Voir notre article).
A lire également :
- 12% des salariés exposés à au moins une substance cancérogène
- Prévention des cancers professionnels : encore des efforts à fournir
- Cancers pro : la poly-exposition est un facteur aggravant, estiment les juges
Auteur : Pauline Chambost, actuEL-HSE.