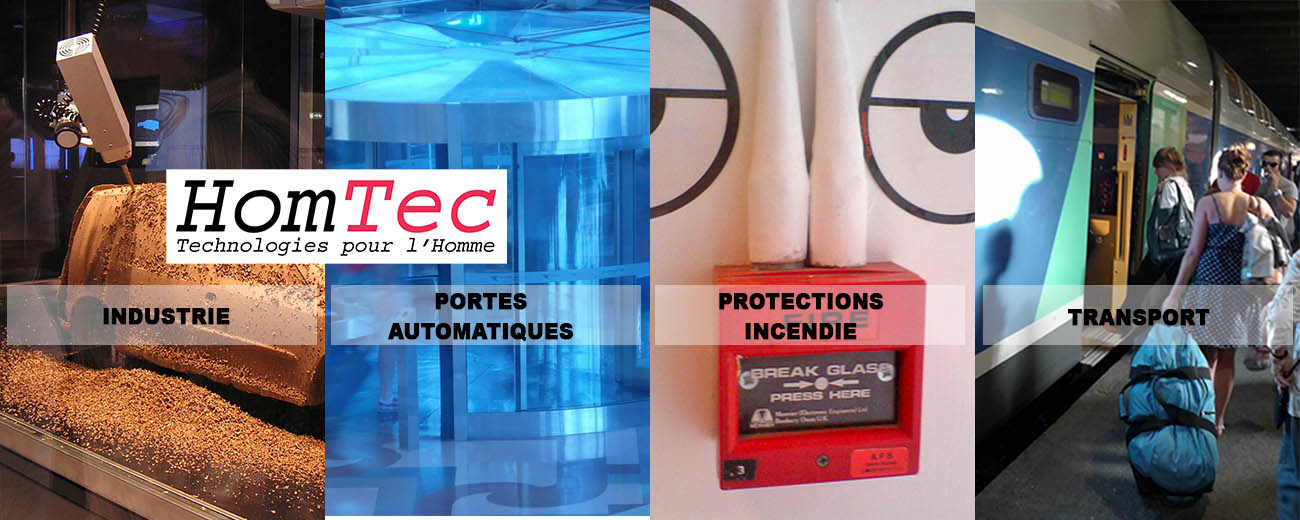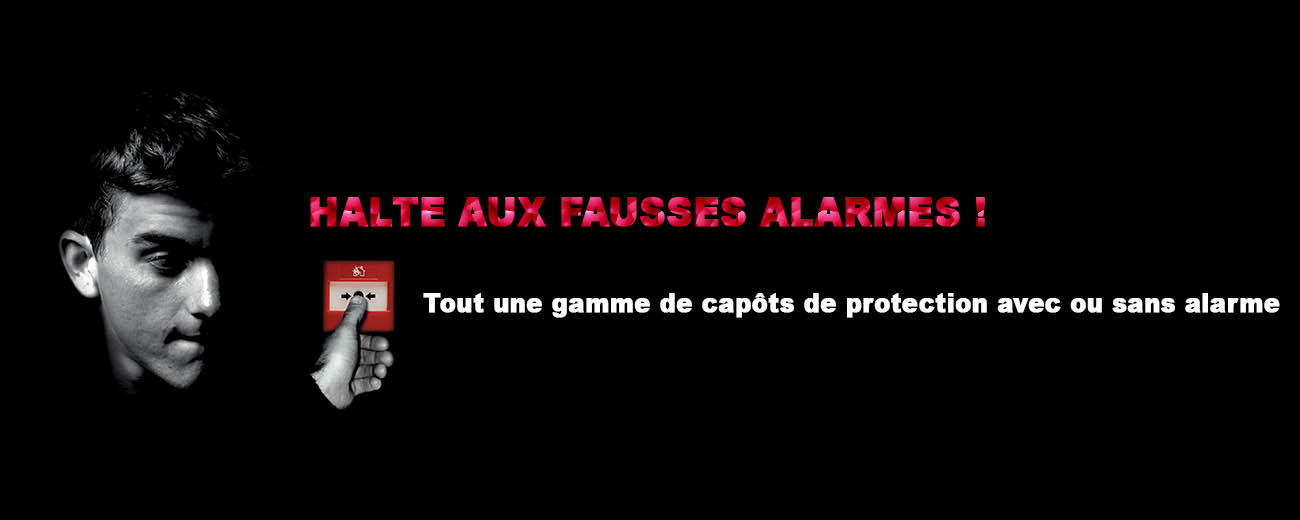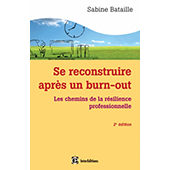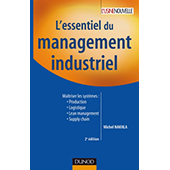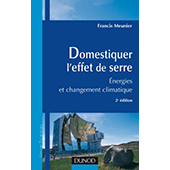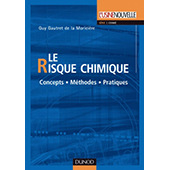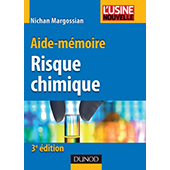Ils entrevoient néanmoins des pistes d'amélioration, notamment via la "territorialisation" de la santé au travail.
En 2007 déjà, en rendant un rapport sur la réforme de la médecine du travail, le professeur Paul Frimat avait l’impression que sa matière était "au milieu du gué". "Je pense que nous y sommes toujours", a-t-il déploré mardi 3 février 2015, lors des 5e rencontres parlementaires pour la santé au travail. "En tant qu’ancien dans le domaine, je dirais qu’il ne faut pas être naïf. Il y a effectivement des changements. Mais pour 90 % du monde économique, la santé au travail reste un empêcheur de tourner en rond", poursuit celui qui est aussi président du conseil scientifique de l’Anses, à l’adresse des élus venus parler de l’efficacité des politiques de santé au travail.
Bilan (très) mitigé
Ses voisins de table ne se sont pas montrés beaucoup plus optimistes. "Si l’on demande aux dirigeants de faire le choix entre santé au travail et business model, ce choix est vite fait", rapporte Laurence Saunder, dirigeante de l’Ifas (institut français d’action sur le stress). Un constat que confortent les propos de l’avocate Laura Ferry. "Le nombre de maladies professionnelles est en explosion", assure-t-elle : "40 000 cas sont actuellement pris en charge par la sécurité sociale" [chiffres de 2009, NDLR]. Autour de la table, on aborde aussi "l’inefficience des actions de prévention des risques psychosociaux" alors que ces risques ne sont d’ailleurs "pas clairement définis" selon l’avocate, la complexité de la mise en oeuvre du compte pénibilité – qui "reste un compte de réparation", fait remarquer Paul Frimat – et la menace qui plane sur l’avenir des CHSCT.
"On est en train de faire le boulot"
En charge des questions de santé au travail à la CFDT et à ce titre membre du Coct (conseil d’orientation des conditions de travail), Hervé Garnier estime de son côté qu’il "faut aussi dire quand les choses se passent bien". "Depuis deux ans, dans le cadre du Coct, les partenaires sociaux essaient de faire évoluer le système", affirme-t-il, "via le plan santé au travail 3 par exemple" – dont les orientations, décidées par le conseil, ont été validées le 27 janvier par le ministre du Travail. "On est en train de faire le boulot", poursuit-il tout en insistant sur le nécessaire accompagnement des entreprises pour la déclinaison dudit plan sur le terrain.
Consensus sur la priorité à la prévention
La première des orientations du PST 3 est la prévention primaire. Un sujet sur lequel il y a consensus, selon Régis Juanico (SRC), député de la Loire et membre du groupe d’étude "pénibilité du travail, santé au travail et maladies professionnelles" : "Tout le monde est d’accord pour dire que la priorité des politiques publiques aujourd’hui, c’est cela." Pour ce qui est du bilan positif des politiques de santé au travail, Yves Struillou, le DGT (directeur général du travail), cite les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, facteurs d’une "dynamique porteuse". Le député Jean-Frédéric Poisson (UMP, Yvelines), auteur d’un rapport sur la péniblité, cite également les "accords santé sécurité au travail mis en place dans de grands groupes", "très bien écrits", et "qui rentrent jusque dans le détail des attributions du directeur de site, ou du DRH".
Un référentiel de compétences des managers

Les attributions du manager sont celles sur lesquelles il faudrait surtout se pencher, selon Hervé Lanouzière, directeur général de l’Anact (agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail). "Il y a un déficit évident entre les exigences managériales et les possibilités des salariés. Ils n’arrivent plus à se comprendre. Et aujourd’hui, on parle de 'management de proximité' mais personne n’est outillé pour", signale-t-il. Avant de poursuivre : "Il faut qu’on arrive à créer un référentiel de compétences des managers, dans lequel employeurs et salariés se retrouvent." Jean-Frédéric Poisson, lui, souhaiterait introduire ce référentiel dès le stade de la formation : "Les futurs managers de ce pays ne sont pas formés à la santé au travail. Il faudrait intégrer cette composante dans les référentiels des écoles et des universités." Et sans forcément attendre le feu vert des établissements en question, à l’en croire : "L’Etat est responsable du cadre pédagogique dans lequel les diplômes de management sont donnés. C’est aux pouvoirs publics de s’engager dans l’introduction de modules sur le sujet dans les cursus des managers".
La "territorialisation des conditions de travail"
Autre piste à suivre, d'après les intervenants des rencontres parlementaires : ce que Xavier Breton député UMP de l'Ain et membre du groupe d’étude sur la pénibilité, appelle la "territorialisation des conditions de travail". Pour lui, elles peuvent devenir "un facteur de développement territorial" – via le développement de technopôles ou de clusters par exemple – et vice versa. "Le cadre territorial, avec son organisation administrative, institutionnelle, permet une proximité, notamment en terme d’espace de production, on peut s’y retrouver facilement, et mieux y articuler les temps sociaux au temps de travail", développe-t-il. Allant dans son sens, Jean-Frédéric Poisson prend "l'exemple captivant" d'un accord départemental interprofessionnel sur la prévention des risques psychosociaux, expérimenté dans le Var en 2011. Et pourquoi pas une ARST, sorte de déclinaison de l’ARS (agence régionale de santé) pour la santé au travail ? Pour Paul Frimat, une telle entité permettrait en tout cas de mieux toucher les PME et TPE. Les plus rétives, selon lui, aux problématiques de santé au travail.

Auteur : Par Claire Branchereau, actuEL-HSE.
Pour découvrir actuEL-HSE.fr gratuitement pendant 2 semaines, cliquez ici.